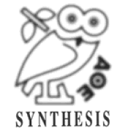 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e158, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e158, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
IdIHCS (UNLP-CONICET)
Centro de Estudios Helénicos (CEH)
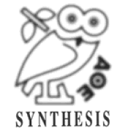 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e158, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e158, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Artículos
Indirection argumentative et mythologie grecque dans l’essai d’Albert Camus
Resumé: Les essais d’Albert Camus sont truffés de références mythologiques. L’invocation de la mythologie grecque, notamment, interpelle: entre l’illustration d’une pensée et l’étayage argumentatif d’un point de vue, le texte essayistique de Camus est jalonné de références mythologiques grecques multiples. Cela ne peut être fortuit et incite à rechercher les raisons d’une procédure appliquée au temps et à la civilisation «modernes». Si on considère que le recours à la mythologie est une espèce d’expression indirecte, il y a lieu également de s’interroger sur la portée d’une parole directe. Quelle efficacité (ou inefficacité) peut avoir dans ce cas l’une et l’autre?
Mots-clés:
Argumentative Indirection and Greek Mythology in Albert Camus' Essay
Abstract: Albert Camus' essays are full of mythological references. The invocation of Greek mythology, in particular, calls into question: between the illustration of a thought and the argumentative support of a point of view, the essayistic text of Camus is strewn with multiple Greek mythological references. This cannot be fortuitous and prompts us to seek the reasons for a procedure applied to "modern" times and civilization. If one considers that the recourse to mythology is a kind of indirect expression, there is also reason to wonder about the scope of a direct speech. What efficiency (or inefficiency) can the two have in this case?
Keywords: Essay, Reference, Greek Mythology, Indirection.
«L’indirection fait que Camus ne désigne pas les choses par leur nom […] Dans l’essai, le recours au mythe […] est une forme de discours détourné» (Chaouch, 2012)
Introduction
Les auteurs du présent article s’interrogent sur les références répétées et multiples à la mythologie grecque dans le texte essayistique de Camus. Beaucoup de questions se posent en effet, quant à la récurrence de ces citations. Faut-il y voir la simple illustration d’une pensée? L’expression argumentée d’une position? Dans ce cas, pourquoi l’essayiste, pour exprimer un point de vue relatif aux problèmes de son temps, recourt-il à la mythologie grecque? Ne peut-il puiser des arguments dans la société et la civilisation “modernes” ? Voire: peut-on considérer que le recours à la mythologie est une voie détournée, un substitut de l’expression directe? Cette circonlocution relèverait-elle de l’allégorie? Si on considère que le détour mythologique s’apparente à une expression indirecte et aurait un contenu implicite, lequel serait-ce dans ce cas? D’autre part, si on admet qu’il y aurait une signification implicite derrière la littérale, on est en droit de s’interroger si, de la part de l’essayiste, cela relève d’un choix ou d’une nécessité. Dans le premier cas, on ne peut pas exclure la thèse du calcul et de la préméditation. Enfin, si on accepte la thèse de l’indirection par le mythe ou indirection mythologique en tant que moyen d’expression, quelle en serait l’efficacité? En cas d’échec de la parole indirecte, la parole directe (même avec le concours de la référence mythologique), peut-elle constituer un palliatif ou un succédané pour garantir un effet perlocutoire?
1. Préliminaires théoriques
Avant d’entamer l’analyse du corpus retenu supra, certaines notions doivent être définies, compte tenu de la nature du corpus qui les convoquera nécessairement.
1.1. L’essai
Considérons infra la définition générale suivante:
1580 Ouvrage littéraire en prose de facture très libre, traitant d’un sujet qu’il n’épuise pas ou réunissant des articles divers. Les Essais de Montaigne.” (Dictionnaire Le Petit Robert)
Définition vague, certes, mais comprenant des informations relatives à la nature de l’écrit, “littéraire”, et à la forme de l’expression, “de facture très libre”. De plus, dans ce qui est considéré comme une référence incontournable en matière d’essai, Montaigne cite à plusieurs reprises Virgile et Lucrèce. Ces derniers détails nous ramènent au sujet qui nous préoccupe, les références gréco-latines des essayistes, point sur lequel nous reviendrons plus loin. Pour “compléter” cette approche de l’essai, nous en distinguerons deux types: l’essai philosophique (cas de L’Homme révolté) et l’essai littéraire (cas de L’Été). Distinction artificielle, quand on pense que la transgression générique dans l’essai est la règle.
1.2. La référence
Selon Wikipédia, le “mot référence correspond à une information (ou un élément) qui sert de guide (de repère) pour une autre”. On aura compris que l’élément important, “dominant” de la définition est le mot “guide”, explicité par le mot “repère”. Cela nous permettra plus loin de situer le texte essayistique de Camus par rapport à l’évocation de la mythologie grecque.
1.3. La mythologie
D’après le Dictionnaire Le Petit Robert, cela désigne l’“ensemble des mythes, des légendes (propres à un peuple, à une civilisation, à une religion. La mythologie hindoue, grecque”.
1.4. La polyphonie
La notion renvoie évidemment à Bakhtine et à sa théorie dialogique de la plurivocité. C’est ce qu’affirme Volochinov, et derrière lui Bakhtine (1977, p. 136): “L’acte de parole sous forme de livre est toujours orienté en fonction des prises de parole antérieures [et nous ajouterons postérieures] tant celle de l’auteur lui-même que celle d’autres auteurs”.
1.5. Intertextualité / intra-intertextualité ou intratextualité
En partant de la théorie dialogique de Bakhtine, on constate que l’intertextualité s’inscrit dans le cadre de la polyphonie, où l’intertextualité en tant que voix postérieure produit une espèce d’écho par rapport à une voix antérieure, celle de l’intertexte. Auparavant, la notion a déjà fait l’objet de réflexions et d’analyses, celle d’un Barthes (1973), d’un Riffaterre (1980), d’un Genette (1982). Pour ne pas trop nous étendre sur la question de la ressemblance ou de la dissemblance des conceptions, nous nous en tiendrons à la définition de Riffaterre (1980, p. 4) qui a le mérite de la clarté et de la simplicité: “L’intertextualité est la perception, par le lecteur, de rapports entre une œuvre et d’autres, qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent l’intertexte de la première”.
Pour notre part, l’intertextualité nous interpelle en tant qu’indirection. Et pour réduire le champ de recherche, nous privilégierons ce que Brian T. Fitch (1982) a appelé l’“intra-intertextualité” ou intertextualité interne. Il se trouve qu’en matière de référence mythologique, bon nombre de textes de Camus s’interpellent, se répondent et se font écho,1 nous nous en contenterons. Dans ce cas, la question pourrait être traitée en termes d’autoréférence ou d’autocitation que permet une lecture paradigmatique ou mise en relation de textes d’un même auteur, dans lesquels un lecteur peut percevoir et relever un retour de thèmes, entre autres. Par exemple, l’idée du héros “révolté” ou “persécuté”, présente dans Le Mythe de Sisyphe (1942), a été reprise dans L’Été (1946) puis dans L’Homme révolté (1951).
Sur le plan pragmatique, nous sommes amenés à nous poser des questions: pourquoi les références à la mythologie grecque sont-elles si nombreuses dans le texte essayistique de Camus? Que l’auteur l’ait prémédité ou non, cette résonance, ce rappel, présentent des “avantages” indéniables, car derrière cette récurrence, il y a une intention communicative et un effet perlocutoire recherché. D’abord, il faut signaler que “l’intratextualité”, terme que nous devons à Kareen Martel (2005) qui correspond à ”l’intra-intertextualité” de Fitch, peut être conçue, dans une perspective isotopique, comme un facteur de cohésion entre les textes d’un même auteur, une espèce de fil conducteur et au-delà, elle peut représenter un ”continuum”. L’objectif de l’essayiste Camus qui reprend le topos de ”l’homme révolté” dans Le Mythe2, dans L’Homme révolté3, dans L’Été4 est de créer un climat de “confiance”, de “familiarité”, voire de “complicité” (Martel, 2005, p. 99) avec le lecteur. Une fois le climat de confiance, de familiarité et de complicité assuré, le texte essayistique peut aisément être perçu comme un appel implicite à la “bienveillance” (Martel, 2005, p. 99) de ce même lecteur que l’essayiste aura entouré de tous les égards. Moyen efficace pour parer à toute contestation. Extrapolation? Surinterprétation? Nullement, si on part du postulat de la non-innocence du langage et de l’intention communicative préalable chez tout sujet parlant producteur d’un énoncé, indifféremment de son statut ou de sa renommée. L’essayiste, en ce faisant, aura réussi perlocutoirement à susciter l’intérêt, à faire en sorte que le lecteur se sente impliqué affectivement, et ce sentiment trouvera sa légitimité s’il concorde avec ce que H. R. Jauss (1994) appelle l’“horizon d’attente”. D’autre part, si on admet que ce lecteur “fidèle” en arrive à ressentir “l’attrait de la familiarité” (Martel, 2005, p. 99), rien n’interdit de considérer l’intratextualité mythologique chez Camus comme une entreprise de séduction.
1.6. Le pamphlet
Selon Le Trésor de la Langue Française (informatisé), le pamphlet est un “court écrit satirique, souvent politique, d’un ton violent, qui défend une cause, se moque, critique ou calomnie quelqu’un ou quelque chose”. A ce sujet, nous croyons identifier dans le chapitre intitulé “L’exil d’Hélène” (dans L’Été) une dimension pamphlétaire de l’essai, toujours par le biais de la mythologie. Nous y reviendrons plus loin.
2. Méthodologie
Conscients que le recours à la mythologie pour exprimer des idées et faire part d’une position dans le travail de réflexion d’un auteur n’est pas une nouveauté, nous nous sommes cependant intéressés à cette démarche, telle qu’elle est illustrée dans le texte essayistique d’Albert Camus. Nous avons dû opérer un choix restrictif de notre corpus. Nous avons retenu le chapitre intitulé “Les fils de Caïn” de L’Homme révolté et les chapitres “Prométhée aux enfers”, “L’exil d’Hélène” de L’Été. Un souci méthodologique nous a dicté d’abord d’installer quelques notions et définitions avant de procéder à l’analyse du corpus retenu. Cette partie du travail ne prétend pas à l’exhaustivité, elle sera volontairement succincte. Elle ne dépassera pas le cadre du rappel de notions incontournables dans le présent travail: l’essai, la référence, la mythologie, l’intertextualité à laquelle nous privilégierons “l’intra-intertextualité”. Considérant qu’une analyse de type littéraire est un chemin déjà arpenté, compte tenu de la célébrité du texte et de son auteur, nous avons humblement estimé qu’un regard sous l’optique de la théorie linguistique pouvait constituer un modeste apport rhématique, ce qui s’inscrit dans l’esprit de recherche qui se nourrit de nouveauté.
Cette première partie, concise mais nécessaire, servira de soubassement aux deux autres parties de l’analyse proprement dite. La deuxième partie, avec le concours de la théorie linguistique, consistera à répondre aux questions posées en introduction, relatives à la thèse de l’indirection mythologique que nous nous appliquerons à défendre. Reste la troisième partie qui sera réfléchissante, une fois la thèse de l’indirection confirmée. Se posera alors la question des limites de la démarche de l’essayiste et de son efficacité.
Nous avons constitué un corpus d’exemples notés de (1) à (17) tirés de la version de la Bibliothèque de La Pléiade des Éditions Gallimard (1965) intitulée Essais. La référence au texte-corpus sera indiquée entre parenthèses comme suit (date de parution 1965, suivie du numéro de la page).
3. Analyse
3.1. Détour mythologique et implicite
Il faut d’abord signaler que la référence à la mythologie grecque est pléthorique: soit à travers les héros tragiques tels que Prométhée, Achille, Œdipe, Antigone, Iphigénie (présents dans L’Homme révolté), soit à travers ce que Camus appelle les ”théogonies”, récits conçus par des Grecs passés à la postérité, tels que Eschyle, Épicure, Platon… Il ne nous intéresse pas, dans la perspective de cette recherche, de revenir en détails, et surtout pas d’un point de vue littéraire, sur ces récits qui relèvent de la culture universelle.
Considérons plutôt que le recours à la mythologie, en lieu et place d’une expression directe, est en lui-même une indirection, une voix détournée, car ce discours biaisé qui fait référence à une civilisation ancienne tend à s’appliquer à l’époque moderne. Soit les énoncés:
(1) Les Grecs n’ont jamais fait de la pensée, et ceci nous dégrade par rapport à eux, un camp retranché (Camus, 1965, p. 440).
(2) La notion du dieu personnel, créateur et donc responsable de toutes choses, donne seule son sens à la protestation humaine (1965, p. 440).
(3) Tout le malheur des hommes vient de l’espérance qui les arrache au silence de la citadelle, qui les jette dans les remparts de l’attente du salut (1965, p. 441).
De (1), on peut inférer:
(1’): Nous avons fait de la pensée un camp retranché, une fortification qui la rend inaccessible.
(1’’): Les Grecs sont supérieurs à nous, autrement, ils sont plus intelligents.
D’autre part, (1) renferme une valeur illocutoire (désormais Vi) de critique, voire de reproche.
(2) a pour Vi un appel à la sédition, à la révolte contre le pouvoir absolu d’un ”dieu personnel, créateur et donc responsable de toutes choses”, un rejet de la condition humaine. Et si on pousse l’extrapolation plus loin, ce serait une profession de foi, autrement, une déclaration d’athéisme. Le mot ”contestation” est dans ce cas euphémique.
De (3), on peut inférer:
(3’): Que les hommes n’espèrent plus et n’attendent plus le salut (venant des dieux).
(3’’): Si salut il doit y avoir, il ne viendra que par l’homme.
Il en découle que (3) peut constituer un appel à la prise de conscience (Vi).
La construction du contenu implicite des énoncés supra peut soulever des objections: ce serait une surinterprétation, on ferait dire au texte et à son auteur ce qu’ils ne disent pas; à ceci, nous répondrons:
a. Bien que l’implicitation relève du travail interprétatif du destinataire (du lecteur que nous sommes, entre autres), cela ne dégage pas pour autant la responsabilité de l’auteur. Quel moyen plus efficace que de dire sans donner l’impression de dire, de se réfugier derrière la signification littérale, au moment de rendre des comptes? De nier complètement, de rejeter le contenu implicite, de ne pas assumer la responsabilité du dire et de désigner un coupable, le destinataire?
b. Bien plus: si on inscrit les inférences dans une configuration polyphonique, où le narrateur (locuteur) serait assimilé à un metteur en scène qui dirige des acteurs (énonciateurs), on peut envisager qu’il puisse s’associer à l’un de ses personnages (énonciateurs) et en épouser le point de vue, indirectement, sans donner l’impression de le faire. Un romancier use d’une pratique similaire, il choisit l’un de ses personnages et il en fait son porte-parole. On ne peut trouver procédé plus subtil pour passer un message, en toute sécurité, sans être suspecté de l’avoir produit.
Œuvrant toujours dans la finesse et la délicatesse, à partir du discours des “Anciens” par exemple, l’essayiste produit un métadiscours à allure de conclusions qu’il peut faire siennes. Voici des exemples suivis de leurs conclusions en italiques:
(4) Lucrèce précise: ‘La substance de ce vaste monde est réservée à la mort et à la ruine’ (1965, p. 440).
→ (4’): Pourquoi donc remettre la jouissance à plus tard?
(5) D’attente en attente, dit Épicure, nous consumons notre vie et nous mourons tous à la peine (1965, p. 440).
→ (5’): Il faut donc jouir.
(6) Et Lucrèce renchérissant: ‘Il est incontestable que les dieux, par leur nature même, jouissent de l’immortalité au milieu de la paix la plus profonde, étrangers à nos affaires dont ils sont tout à fait détachés’ (1965, p. 441).
→ (6’): Oublions donc les dieux, n’y pensons jamais…
En fait, la tactique est claire: le détour mythologique (la caution des ”Anciens”) est une espèce de préliminaire, une précaution oratoire qui fait admettre ce qui peut être un sujet de contestation (la mise en cause du destin, la critique des dieux et la réaction de l’homme sous la forme des deux conclusions supra). Cela ressemble, à s’y méprendre, à ce que Beji (2022, p. 95) appelle “un ‘pré’ ou préliminaire précédant un reproche qui peut être interprété comme une atteinte à la face positive de l’interlocuteur”. Il s’agit là d’une manœuvre stylistique, d’une ruse, d’une astuce, qui permet, pour reprendre Ducrot (1972, p. 15) de “faire croire sans avoir dit”, en s’exposant le moins possible. On part du “principe” que derrière une signification littérale, il y a toujours une signification implicite.
3.2. Détour mythologique et argumentation
3.2.1. “Modèle” et argument ad vericundiam
A ce stade, il y a lieu de s’interroger sur cette “prolifération” des références mythologiques et particulièrement sur l’invocation des héros tragiques et des “Anciens”. Si on considère le cas de L’Homme révolté, on constate que l’essayiste raisonne par analogie, Prométhée est cité en exemple, voire en modèle, or pour la rhétorique d’Aristote, le logos (comprenant des arguments rationnels) est illustré par l’analogie et l’exemple, l’essayiste s’inscrit en héritier de cette rhétorique :
(7) L’inépuisable génie grec, qui a fait la part si grande aux mythes de l’adhésion et de la modestie, a su donner, cependant, son modèle à l’insurrection. (1965, p. 438). Cependant, il ne faut pas s’en tenir à l’admiration que l’essayiste voue au “génie grec”, il faut surtout considérer l’exemple et l’analogie en termes de poids argumentatif. Ce poids est d’autant plus “pesant” qu’il s’inscrit dans cette “intra-intertextualité” qu’on a évoquée au début. Au Prométhée de L’Homme révolté répond en écho celui de L’Été:
(8) On pourrait dire sans doute que ce révolté dressé contre les dieux est le modèle de l’homme contemporain et que cette protestation élevée, il y a des milliers d’années, dans les déserts de Scythie, s’achève aujourd’hui dans une convulsion historique qui n’a pas son égale (1965, p. 841).
Pourquoi cette insistance, cette récurrence de la référence? Pour la citer en tant qu’exemple ou de modèle, pour apporter une crédibilité en matière d’argumentation. Le modèle est d’autant plus mis en valeur, quand il sert d’argument d’autorité. La citation de Lucrèce et d’Épicure supra n’est donc pas innocente. Preuve, témoignage de vérité? Ou, comme le pense Nathalie Piégay-Gros (1996, p. 40) “stratégie d’écriture délibérée”? La question se pose et s’impose. Pour nous, quand la référence (ou la citation) est érigée en pratique systématique, cela interpelle (c’est le cas dans L’Homme révolté et L’Été, en l’occurrence). Comme le font remarquer Beji, Chaouch, Zemni & al. (2022, p. 7): “L’autorité invoquée et citée en renfort (même indirectement) sert de fondement et de garant de la validité des propos du locuteur”. Quoi qu’il en soit, excès ou abus de la référence mythologique, cela renvoie au mythologisme en tant que système de pensée, d’interprétation utilisant la mythologie. Reste à définir l’objectif d’un tel système de pensée.
3.2.2. Les figures de rhétorique
Il n’est pas dans notre intention de procéder à l’analyse des figures de rhétorique qui relèvent de ce qu’on appelle la rhétorique restreinte, la stylistique y pourvoit. Ces figures nous intéressent, par contre quand elles sont au service d’une argumentation. Qu’elles prennent la forme de l’allégorie, de la parabole, de la métaphore, de l’allusion, elles illustrent d’une façon ou d’une autre ce que nous avons appelé l’indirection mythologique ou discours oblique. D’un point de vue méthodologique, quelques rappels définitoires ne seront pas superflus.
3.2.2.1. L’allégorie
Dans le dictionnaire Trésor de la Langue Française, (abrégé en TLF), l’entrée du mot allégorie en donne la définition suivante: “Mode d'expression consistant à représenter une idée abstraite, une notion morale par une image ou un récit où souvent (mais non obligatoirement) les éléments représentants correspondent trait pour trait aux éléments de l'idée représentée”. Forme d’expression imagée, indirecte donc, qui cache derrière le sens littéral, un sens implicite.
3.2.2.2. L’allusion
Dans le TFL, ce terme est défini comme suit: “RHÉT. Figure par laquelle certains mots ou tournures éveillent dans l'esprit l'idée d'une personne ou d'un fait dont on ne parle pas expressément”.
Le terme se retrouve dans l’expression faire allusion à (qqn ou qqc.). “Évoquer indirectement quelqu’un ou quelque chose” (Le Robert).
3.2.2.3. L’analogie
“Dans son sens vague et courant, l’analogie désigne une ressemblance plus ou moins lointaine entre deux ou plusieurs grandeurs entre lesquels on admet implicitement une différence essentielle” (Greimas & Courtés, 1979).
3.2.2.4. La métaphore
La métaphore est la figure par laquelle on désigne un référent en utilisant un autre signe que celui qui le désigne couramment, par une comparaison sous-entendue comme on la définit d’ordinaire (le printemps de la vie = la jeunesse) (Charaudeau & Maingueneau, 2002).
3.2.2.5. L’ironie
La rhétorique la décrit traditionnellement comme un trope qui consiste à dire le contraire de ce qu’on veut faire comprendre au destinataire. Dans l’ironie, il y a en effet non-prise en charge5 de l’énonciation par le locuteur et discordance par rapport à la parole attendue dans tel type de situation (Charaudeau & Maingueneau, 2002). Ces formes d’expression partagent la propriété d’être imagées et indirectes. Pour laisser la stylistique aux stylisticiens, nous les considérerons en tant qu’outils argumentatifs.
Considérons le mythe de Prométhée et reprenons l’exemple (8). Si le mythe en lui-même relève de la légende,6 l’invoquer revient à en faire l’allégorie de l’injustice (divine) et de la révolte humaine (contre le destin), parallèlement, on établit une analogie entre la condition de l’homme légendaire et celle de l’homme d’aujourd’hui. Pour schématiser, on met en relation deux éléments que l’on désignera par A (élément précédent, chronologiquement, soit le mythe) et B (élément suivant, l’homme d’aujourd’hui). Dans ce cas, l’analogie, comme le pense Christian Plantin (1996, p. 49), “joue un rôle dans les argumentations où l’on met en avant un précédent, où l’on rapporte le cas présent à un cas typique, où l’on propose de suivre un modèle”. De son côté, Cécile Voisset-Vesseyre (2012, p. 101) allie l’allégorie à l’analogie dans une espèce de fusion indifférente à la chronologie, de symbolisme du mythe mis au service d’une argumentation: “Prométhée c’est nous dans notre grandeur, notre présent et notre avenir ; c’est ce qu’il y a de grand en l’homme : sa capacité à se lever et à se soulever, à se retourner et à affronter”.
Pour revenir à la définition de l’allégorie, derrière le sens premier (explicite), en l’occurrence les souffrances de Prométhée, il y a un sens (implicite) que l’essayiste révèlera en (9):
(9): L’homme d’aujourd’hui est en effet celui qui souffre par masses prodigieuses sur l’étroite surface de cette terre, l’homme privé de feu et de nourriture pour qui la liberté n’est qu’un luxe qui peut attendre (1965, p. 841).
Quel impact à l’usage du mythe, de l’allégorie et de l’analogie? D’abord, Camus a compris que si l’analogie fait appel au logos (selon Aristote), il a la “conviction que les vieilles légendes sont riches d’enseignement et porteuses d’une vérité profonde” (Jouanno, 2008, p. 198); d’un autre côté, l’usage de l’allégorie n’est pas sans lien avec le pathos (Amossy, 2000, p. 184), à travers toutes ces images du héros enchaîné, “persécuté”, “aux enfers”, souffrant le calvaire, ne pouvant se libérer, supplicié, parce qu’il avait osé défier les dieux.
De son côté, la métaphore est une autre figure en rapport avec l’analogie, répétitive, illustrant cette idée de la résonance qui caractérise l’intratextualité, et autrement cette indirection qui consiste à désigner “une chose par une autre” sur la base de la similitude. Et quand la métaphore est récurrente, cela donne lieu à une constellation métaphorique. Dans notre représentation, une flèche introduira la métaphore:
a) L’année de la guerre → la porte ouverte de l’enfer.
b) Le périple d’Ulysse → à la rencontre de la lumière.
La métaphore a) évolue en métaphore filée:
c) La porte de l’enfer > nous étions dans l’enfer > sans feu ni soleil.
Cette accumulation de figures en c) vise à “exciter les passions pour persuader” (Amossy, 2000, p. 185).
Soit l’énoncé (10) qui présente le double avantage d’être allusif et ironique:
(10): Ses modèles [ceux de la révolte métaphysique] sont pourtant bien lointains, puisque notre temps aime à se dire prométhéen (1965, p. 438).
À qui l’essayiste fait-il allusion et qui tourne-t-il en dérision? Identifier l’objet de l’allusion ou de l’ironie n’est pas en soi aussi important que l’explication du processus et l’usage de ces deux figures dans l’argumentation.
Partons d’abord de deux définitions prototypiques de l’ironie, traditionnellement reconnues, bien que limitées, celle de Dumarsais (1977, p. 141) qui la définit ainsi: “L’ironie est une figure par laquelle on veut faire entendre le contraire de ce qu’on dit : ainsi les mots dont on se sert dans l’ironie ne sont pas dans le sens propre et littéral”. Et celle du Petit Robert (2013): “Ironie. Manière de se moquer (de quelqu’un ou de quelque chose) en disant le contraire de ce que l’on veut faire entendre”.
La première invoque l’antiphrase et le jeu entre le sens propre et le sens figuré. La seconde, tout en reprenant le trait définitoire antiphrastique, dépasse le cadre des mots pour illustrer une “manière” une technique de dévalorisation d’une cible par la raillerie. La première définition est contestable, en ce sens, comme l’affirme à juste titre Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 199): “Toutes les moqueries n’exploitent pas le procédé sémantique de l’antiphrase, et toutes les antiphrases ne fonctionnent pas pragmatiquement comme des moqueries”.
Il faut d’abord signaler que ce qui nous a mis sur la piste de l’ironie, c’est un indice, un “mot d’alerte” (Morier, 1989, p. 607), en l’occurrence “aime à se dire”, compte tenu du fait que l’ironie se caractérise, entre autres, par la dissimulation. A l’expression soulignée supra, on peut aisément substituer le verbe “prétendre”, sans grand dommage pour le sens. Il y a un effet de distanciation critique et surtout une dissociation énonciative, une espèce de “schizophrénie dans le langage” (Ducrot in Préface à Scapoline, 2004, p. 10). Dans le cas de (10), l’ironie est assimilée à “une tromperie ouverte, [un] double jeu énonciatif contradictoire où le locuteur feint hypocritement et paradoxalement d’adhérer au point de vue qu’il rejette” (Perrin, 1996, p. 258). Dans le possessif de “notre temps” est inclus le je qui donne l’impression (ou feint) de faire partie d’un nous qui se dit prométhéen. Pour illustration, nous citons Alain Rabatel (2012, p. 43) : “Le PDV ironique fait l’objet dans un premier temps d’une prise en charge feinte du PDV explicite (PDV1), avant que l’énonciateur fasse implicitement entendre son véritable PDV (PDV2), un PDV plus pertinent que PDV1”.
En schématisant, cela donne ce qui suit:
PDV explicite (PDV1): notre temps est prométhéen.
PDV implicite, “véritable PDV” de l’énonciateur (PDV2): notre temps n’est pas prométhéen.
Parallèlement, à travers la figure ironique, se dessine la configuration polyphonique d’un locuteur LOC qui met en scène deux énonciateurs E1 et E2, il choisit de se dissocier de E1 dont il rejette le point de vue (PDV1) et de s’associer à E2 (ou de prétendre s’associer à lui) en épousant PDV2. Les phénomènes d’association et de dissociation s’accompagnent parallèlement de phénomènes de prise en charge et de non-prise en charge (d’un point de vue). Dans le cas de (10), LOC ne prend pas en charge PDV1 de E1. Il y a contradiction et paradoxe dans cette fausse adhésion à PDV1. Alain Berrendonner (1981, p. 215) va plus loin que L. Perrin : en faisant de l’ironie, LOC “[s’inscrit] en faux contre sa propre énonciation, tout en l’accomplissant”, d’où le paradoxe dans cette adhésion feinte. Simulacre, jeu entre l’être et le paraître, mise en scène, théâtralisation (si on ajoute au dire la posture, la gestuelle, la mimique, l’intonation). L’ironiste est sûr de sa “force”, d’un sentiment de supériorité, quand il déclenche un rire moqueur aux dépens d’une cible qu’il dévalorise, pendant qu’il s’auto-valorise.
En termes d’argumentation, un schéma peut révéler deux propositions:
Soit P (“notre temps est prométhéen”), qui, par inférence, oriente vers une conclusion r (il a le sens de la révolte), Q (“notre temps n’est pas prométhéen”), qui par inférence, oriente vers une conclusion non-r (“il n’a pas le sens de la révolte”), les deux propositions sont anti-orientées. Q semble être un argument plus fort pour non-r.
A qui l’essayiste fait-il allusion dans (10) à travers l’expression “notre temps”? Là encore, l’intratextualité peut être invoquée pour trouver un élément de réponse. Les lecteurs de L’Homme révolté savent qu’à sa parution, il a soulevé tout un tollé de protestations, de récriminations, de critiques véhémentes, l’essayiste s’est attaqué aux intellectuels de gauche, les surréalistes, les communistes et les existentialistes, qu’il appelait “nos philosophes” ou “nos moralistes”7 et il a ouvert les portes de l’enfer. L’essayiste ne nomme pas expressément la cible de ses attaques (dans (10), du moins), il suggère, il suscite, il insinue, il fait allusion à sa cible, il emprunte un chemin détourné, indirect et c’est le propre de l’allusion. Dans (10) se réalise une double indirection: celle de l’allusion et celle de la mythologie. Deux précautions valent mieux qu’une.
Il est temps à présent de poser la question essentielle: l’indirection mythologique est-elle un choix ou une nécessité? Un calcul ou un déterminisme?
L’indirection mythologique dans le cas de (10) est un choix et une nécessité; cela tient essentiellement à la nature de l’implicite et aux avantages qu’il représente pour celui qui y recourt. De plus, si on tient compte du fait que l’essayiste est un philosophe (même s’il n’aime pas le reconnaître), que le discours qu’il produit relève de l’essai philosophique, compte tenu de l’admiration qu’il voue à la culture grecque (considérée comme un modèle), le détour mythologique est incontournable.
Une parole directe (à dimension critique) est jugée agressive, elle incrimine, responsabilise et expose à des poursuites. Donc une prise de parole qui ne produit pas l’effet perlocutoire escompté (une prise de conscience, par exemple). Une parole indirecte, cependant, est précautionneuse et calculatrice: elle dégage le locuteur de toute responsabilité et elle met à l’abri de tous les désagréments.
L’exemple (10), baignant dans les eaux troubles de la mythologie, de l’ironie, de la polyphonie ne permet pas de désigner le locuteur L comme coupable. Mis le dos au mur au moment des comptes, L peut invoquer la signification littérale ou Sl ou et accuser l’auditeur A, dont le travail interprétatif le conduit à construire le contenu implicite. C’est moins compromettant, quand on adopte la logique enfantine ce n’est pas moi, c’est lui. L (en tant que metteur en scène) peut toujours rendre un énonciateur E responsable d’un PDV. Tactique habile et subtile qui permet de s’investir “mine de rien”. D’un autre côté, certaines lois du discours sont respectées à la lettre: si on s’en tient au dit, l’essayiste dit peu (principe d’économie); parallèlement, la parole indirecte est plus pertinente (principe de pertinence), plus efficace qu’une parole directe qui déclenche une réaction de rejet. Bref, l’indirection peut être assimilée à un comportement de roublardise pour contourner les règles et les principes. C’est moins choquant, plus élégant, en ce sens que cette parole indirecte, vêtue de l’habit de la mythologie et de la polyphonie, préserve la face positive de A (en ne l’agressant pas directement, mais plutôt en le ménageant par une parole adoucissante, caressante, édulcorée, feutrée).
4. Limites de l’indirection mythologique
4.1. Défaillance de l’implicite
L’indirection mythologique, malgré la virtuosité de celui qui y a recours connaît des limites qui tiennent à beaucoup de facteurs. Quand l’essayiste ironise dans (10), n’enfreint-il pas certaines lois du discours qu’il a feint de respecter dans un premier temps? En étant économe de paroles, n’a-t-il pas transgressé la loi d’exhaustivité qui stipule qu’il est amené à fournir le maximum d’informations ? En cachant certains éléments (qu’il donne à lire implicitement), était-il sincère ou a-t-il caché une partie de la vérité (selon le principe de sincérité) ? Était-il suffisamment clair (selon le principe de modalité du discours8)? Il ne peut, quoi qu’il dise, éviter les questions suspicieuses d’un auditeur: que voulez-vous dire par “notre temps aime à se dire prométhéen”? Qui désignez-vous par “notre temps” ? De qui vous moquez-vous? Questions qui pourraient être suivies d’injonctions: soyez plus clair et dites ce que vous avez à dire sans détours.
Toutes ces interrogations illustrent la faillite de l’implicite en tant que stratégie. De plus, ce discours oblique place l’essayiste mythologisant dans une position inconfortable, quand on le lie à la notion d’“horizon d’attente”. Est-ce là le discours du maître à penser, auteur d’autres essais, plus “posés”, mûrement réfléchis, tels que Noces (1939) ou Le Mythe de Sisyphe (1942)? Surprise, choc ou attente déçue? Ceci pose, effectivement, un sérieux problème de réception. Si on tient compte de l’ambiguïté qui caractérise l’ironie, comment deviner l’intention communicative de l’essayiste? Est-il sérieux ou léger et ironique? C’est que le jeu de la duplicité énonciative n’est pas sans risque. De plus, est-il à la portée de tout lecteur de décrypter une indirection mythologique? Encore faut-il avoir un petit savoir, une petite connaissance des mythes et légendes, une certaine compétence, au sens de Chomsky, cette assimilation du système de règles d’une langue ou d’une culture. Il faut avoir, entres autres un minimum de connaissances sur le fonctionnement de l’implicite et de l’ironie. Comme l’affirme Z. Chaouch (2012, p. 177): “[…]la réception d’un message ironique dépend, entre autres, de la compétence linguistique et encyclopédique de l’auditeur-lecteur et la complicité avec l’ironiste est tributaire du partage d’un univers de valeurs et de croyances”.
Par ailleurs, pour reconsidérer l’intratextualité qui jalonne l’œuvre d’un même écrivain, comme c’est le cas pour Prométhée, présent dans L’Homme révolté (in “La révolte métaphysique”), qu’on retrouve dans L’Été (in “Prométhée aux enfers”), surtout quand il résume par “Les mythes n’ont pas de vie en eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions”, à quel type de lecteur l’essayiste mythologisant s’adresse-t-il? Qui désigne-t-il par ce “nous” inclusif? Un lecteur prototypique, modèle, savant, érudit? De plus, le recours à l’intratextualité est dérangeant en lui-même: serait-ce un “impératif de lecture [qui] gouverne le déchiffrement du message”? (Riffaterre 1980, p.5). Enfin, nous avons déjà signalé une référence mythologique pléthorique chez Camus, autrement appelée “mythologisme”, ce qui dépasse le cadre de la simple admiration du “génie grec”, car ce qui est censé être un argument de poids peut se révéler préjudiciable à l’argumentateur, à nos yeux, trop de référence tue la référence.
4.2. La référence pamphlétaire
Le passage de L’Homme révolté à L’Été connaît une évolution, presqu’une métamorphose, puisqu’après avoir servi de renfort et de soutien argumentatifs, la référence mythologique se fait pamphlétaire dans “L’Exil d’Hélène”, texte assimilable à un réquisitoire: la civilisation grecque, par le biais de l’analogie, mais surtout du contraste, est mise en relation avec la civilisation européenne.
Rappelons d’abord la définition du pamphlet présentée dans le chapitre 1. Le pamphlet est un “court écrit satirique, souvent politique, d’un ton violent, qui défend une cause, se moque, critique ou calomnie quelqu’un ou quelque chose”. A ce sujet, nous croyons identifier dans le chapitre “L’exil d’Hélène” une dimension pamphlétaire, tâchons donc d’y retrouver les traits discriminants ou les invariants du pamphlet. Comme nous le verrons ci-dessous, on retrouvera des éléments pouvant caractériser la satire visant à dénoncer, critiquer des travers, des vices, parfois exagérés et caricaturés, et le ton est souvent violent. Quant à la moquerie, elle peut être implicite. Le caractère pamphlétaire est particulièrement révélé à travers le vocabulaire, mélioratif pour les Grecs, péjoratif pour la civilisation européenne, et au-delà par le biais du contraste, parfois au moyen d’outils syntaxiques. C’est dans cette mesure que la référence mythologique oscille entre l’expression d’une parole indirecte et l’expression d’une parole directe, avec toutes les conséquences sémantiques et pragmatiques qui en découlent. En voici des exemples:
(11) […] si les Grecs ont touché au désespoir, c’est toujours à travers la beauté […] Notre temps, au contraire, a nourri son désespoir dans la laideur et dans les convulsions (1965, p. 853).
(12) Nous avons exilé la beauté, les Grecs ont pris les armes pour elle (1965, p. 853).
(13) La pensée grecque s’est toujours retranchée sur l’idée de limite […] Notre Europe, au contraire, lancée à la conquête de la totalité, est fille de la démesure (1965, p. 853).
(14) L’équité, pour eux, supposait une limite, tandis que notre continent se convulse à la recherche d’une justice qu’il veut totale (1965, p. 853).
(15) Alors que Platon contenait tout, le non-sens, la raison et le mythe, nos philosophes ne contiennent rien que le non-sens ou la raison, parce qu’ils ont fermé les yeux sur le reste (1965, p. 855).
Ce qui illustre la dimension pamphlétaire (critique ou polémique) de ces énoncés, c’est d’abord l’effet de contraste entre deux propositions contradictoires par des outils linguistiques divers:
4.2.1. Le vocabulaire: valorisant vs dévalorisant
Soit: “la beauté” vs “la laideur”, “les convulsions” / “pris” vs “exilé” / “limite” vs “totalité” / ou “équité limitée” vs “équité totale” / “eux” vs “notre continent” /“tout” (le non-sens, la raison et le mythe) vs “une restriction” (le non-sens ou la raison).
4.2.2. La syntaxe
- Par la nominalisation: “les Grecs” vs “notre temps” / “nous” vs “les Grecs” / “la pensée grecque” vs “notre Europe” / “eux” vs “notre continent” / “Platon” vs “nos philosophes”.
- Par des outils de relations syntaxiques (cas de (11), (13), (14), (15)) ou par simple juxtaposition de propositions (cas de (12)).
Toutefois, il faut signaler que, malgré le caractère pamphlétaire (qui pourrait relever de la parole directe), l’indirection est toujours présente: par la référence (encore et toujours à la mythologie), par des substitutions de mots (notre temps pour ”actuellement”, notre continent pour “l’Europe ”, eux pour “les Grecs”). De même que derrière l’usage du pronom personnel ”nous” et ses substituts possessifs “notre”, “nos”; de la part du locuteur, il y a une volonté de s’effacer, de noyer le je dans l’anonymat d’un nous généralisant, astuce pour faire preuve de modestie, peut-être.
Revenons sur les outils de liaison des propositions présents dans (11), (13), (14), (15) que nous avons pris soin de souligner. Ce sont tous des marqueurs de concession (MC) ou des expressions adversatives, ils ont une valeur syntaxique d’opposition et un fonctionnement argumentatif en tant que connecteurs pragmatiques qui donnent des instructions pour une certaine conclusion. Pour schématiser:
(11) P au contraire Q; P a une relation d’inférence vers une conclusion r (soit: à quelque chose malheur est bon); Q a une relation d’inférence vers une conclusion non-r (il n’y a rien de bon dans notremalheur), r et non-r sont contradictoires. Q peut être considéré comme un argument en faveur de non-r. Le même raisonnement peut s’appliquer à (13) et (14), même si le MC (“tandis que”) est différent dans le second cas. (15) peut être illustré par un schéma inversé, soit: Alors que Q, P; par inférence Q est présenté comme un argument fort étayant une conclusion non-r (Platon est supérieur à “nos philosophes”).
(12) est l’exemple qui montre que “[…] le sens des relations de discours peut être appréhendé indépendamment des marques qui sont susceptibles de les qualifier” (Rossary 2000, p. 26), autrement dit, il y a bien une opposition entre deux propositions, en dépit de l’absence des MC qui révèlent cette relation.
Au-delà de toutes les considérations, sémantiquement, chez le locuteur il y a une volonté de “minimisation” de l’Europe, exprimée dans cette conclusion:
(16) “Voilà pourquoi il est indécent de proclamer aujourd’hui que nous sommes les fils de la Grèce” (1965, p. 854).
Pragmatiquement, un effet perlocutoire (soumis à des conditions) est escompté: faire prendre conscience de la “beauté” et conduire à se montrer digne du modèle grec:
(17) “L’ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde et de l’homme, le visage aimé, la beauté enfin, voici le camp où nous rejoindrons les Grecs” (1965, p. 857).
A ce stade de la réflexion, nous pouvons constater que la parole pamphlétaire met la mythologie à contribution pour corriger les travers d’une société critiquée (et c’est en cela qu’elle est satirique); elle est directe par la péjoration lexicale (le vocabulaire dévalorisant caractérisant une société décadente, l’Europe) et indirecte quand elle est au service d’une argumentation, ce qui n’a rien d’étonnant, comme le spécifie Ruth Amossy (2000, p. 159) : “Une partie de l’argumentation repose sur l’implicite”. Il faut ajouter à cette parole pamphlétaire une dimension axiologique, voire déontique, comme c’est le cas dans (17), dans la mesure où derrière l’essayiste se cache le moraliste. C’est en ce sens que ce discours s’apparente à ce que Marc Angenot (1982, p. 49) a appelé “l’essai cognitif” ou “essai diagnostic”. Derrière une apparente objectivité, avec le soutien de la doxa et le partage de certaines valeurs, se dissimule un pamphlet. Ce qui donne l’impression que l’essayiste pamphlétaire prend ses distances et rompt tout lien avec un monde, dans lequel il ne se retrouve pas, dans lequel il se sent étranger.
Pour compléter le portrait du pamphlétaire, Paul Bleton (1985, p. 444) ajoute dans son analyse de l’ouvrage de M. Angenot: “[…] Tout comme il [le pamphlétaire] favorise une rhétorique de l'emphase, du contraste et de l'agression.”. On retrouve dans ce portrait les traits identificatoires du pamphlétaire, tel que nous l’avons montré dans les exemples de (11) à (17). Et c’est à ce stade que la parole, en se faisant plus directe, devient agressive, “choquante”, “révoltante”, révélant par la même occasion, L’Homme révolté qu’est l’essayiste Camus. Et c’est à ce niveau qu’elle risque de perdre en efficacité, en déclenchant une réaction de rejet. L’essayiste qui cherchait à infléchir un comportement, au moyen d’une argumentation misant trop sur le pathos, n’aura peut-être pas obtenu l’effet perlocutoire escompté.
5. Conclusion
Pour conclure, nous espérons avoir montré que la référence mythologique dans le cadre d’un essai est un moyen détourné pour faire part d’un point de vue, pour exprimer une position “philosophique”. Dans le cas présent, l’essayiste Camus a pris pour sujet de réflexion la révolte. En se référant à la mythologie grecque, il a développé une argumentation qui repose la plupart du temps sur l’implicitation laissée aux soins du destinataire de son discours. En lieu et place d’une parole directe qui aurait nécessité le ton solennel, didactique d’un essai philosophique, peut-être pour des raisons d’efficacité, l’essayiste a préféré emprunter une voie oblique en sollicitant l’aide de la mythologie pour convaincre du bien-fondé de son point de vue (à savoir que l’homme moderne est dans une espèce d’apathie, alors que le chemin de la révolte lui a été montré par le modèle grec). Pour construire son argumentation, l’essayiste a dû s’inspirer des “Anciens”, de la rhétorique classique et de ses outils. D’autre part, il a puisé d’autres idées dans l’intratextualité ou la convocation de ses propres textes. Cette dernière ficelle a mis à jour des notions telles que la polyphonie ou l’ironie, des moyens qui peuvent être mis au service d’une stratégie (comment dire sans donner l’impression de dire, sans assumer aucune responsabilité). Un changement s’est effectué par la suite, en passant de la parole indirecte (celle de l’essai philosophique qu’est L’Homme révolté) à une parole (moins indirecte) plus directe (celle de l’essai littéraire qu’est L’Été), dans la mesure où le discours a pris une allure pamphlétaire. La stratégie du mythologisme ou abus de la référence peut montrer ses limites, être rébarbative et décourageante, donc inefficace (à moins qu’elle ne soit destinée à une élite). La stratégie de la parole trop directe qui caractérise le pamphlet peut s’exposer à un rejet, voire inciter à la révolte (pas la métaphysique escomptée par l’essayiste) contre une doctrine: celle du philosophe bien-pensant, dispensateur de savoir, moraliste, idéaliste, voire utopiste. La solution consiste peut-être dans un dosage équilibré de la parole, dans son adaptation à l’image de l’interlocuteur et à l’air du temps.
Remerciements
Ce projet de recherche a été financé par le Département de la recherche scientifique de l'Université Princesse Nourah bint Abdulrahman, par le biais du Programme de financement de projets de recherche après publication, subvention n° (44- PRFA-P- 73). Nous remercions Mashael Aljasser et Rimass Aldayel pour leur aide précieuse et leurs commentaires constructifs.
Referencias
Amossy, R. (2000). L’argumentation dans le discours. Paris: Nathan.
Angenot, M. (1982). Remarques sur l’essai littéraire. In La Parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes. Paris: Payot.
Bakhtine, M. (1977). Le Marxisme et la philosophie du langage. Paris: Minuit.
Barthes, R. (1973). Théorie du texte. Paris: Encycloppaedia Universalis.
Beji, J. (2022). Désamorçage et évitement dans la conversation quotidienne en arabe saoudien et tunisien. Kervan International Journal of Afro-Asiatic Studies, 26, Special Issue.
Beji, J., Chaouch, Z., Zemni, B. & al. (2022). L’Argumentation dans Le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus. Synthesis, 29(2).
Berrendonner, A. (1981). Éléments de pragmatique linguistique. Paris: Minuit.
Bleton, P. (1985 [1982]). Marc Angenot, La Parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Paris, Payot, 1982. Études littéraires, 18(2).
Camus, A. (1965). Essais. Paris: Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade.
Chaouch, Z. (2012). L’écriture de l’essai chez Camus. Tunis: Publications de l’Université de Sousse.
Dubois & al. (1973). Dictionnaire de linguistique. Paris: Larousse.
Ducrot, O. (1972). Dire et ne pas dire. Paris: Minuit.
Dumarsais, C. C. (1977). Traité des tropes. Paris: Le Nouveau Commerce.
Fitch, B. T. (1982). Des écrivains et des bavards: l’intra-intertextualité camusienne. In Cahiers Albert Camus: œuvre fermée œuvre ouverte, Actes du Colloque du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle. Paris: NRF, Gallimard.
Fitch, B. T. (1983). L’intra-intertextualité interlinguistique de Beckett ; la problématique de la traduction de soi. Texte, 2, 85-100.
Genette, G. (1982). Palimpsestes : la littérature au second degré. Paris: Seuil.
Greimas, A. J., &, Courtés, J. (1979). Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette.
Grice, H. P. (1979). Logique et conversation. Communications, 30, 57-72.
Jauss, H. R. (1994). Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard.
Jouanno, C. (2008). Mythe et allégorie dans l’œuvre de Lucien. Kentron, Revue pluridisciplinaire du monde antique, 24, 183-225.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1980). L’énonciation. De la subjectivité dans le langage. Paris: Seuil.
Martel, K. (2005). Les notions d'intertextualité et d'intratextualité dans les théories de la réception. Protée, 33(1), 93-102.
Montaigne, M. (1929). Essais. Paris: PUF.
Morier, H. (1989). Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris: PUF.
Nolke, H. & al. (2004). ScaPoLine, La théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Paris: Kimé.
Perrin, L. (1996). L’ironie mise en trope. Paris: Kimé.
Piégay-Gros, N. (1996). Introduction à l’Intertextualité. Paris: Dunod.
Plantin, C. (1996). L’Argumentation. Paris: Seuil, Mémo.
Rabatel, A. (2012). Ironie et sur-énonciation. Lyon: Université de Lyon1.
Riffaterre, M. (1980). La trace de l’intertexte. La Pensée, 215, 4-18.
Robert (Le Petit) (2013). Dictionnaire analogique. Paris: Le Robert.
Rossary, C. (2000). Connecteurs et relations de discours. Nancy: Presses universitaires de Nancy.
Voisset-Veysseyre, C. (2012). Albert Camus et Prométhée. Amaltea, 4, 101-111.
Trésor de la Langue Française (Le): Dictionnaire de la langue française informatisé.
Notas
Recepción: 11 enero 2024
Aprobación: 15 abril 2024
Publicación: 01 febrero 2025